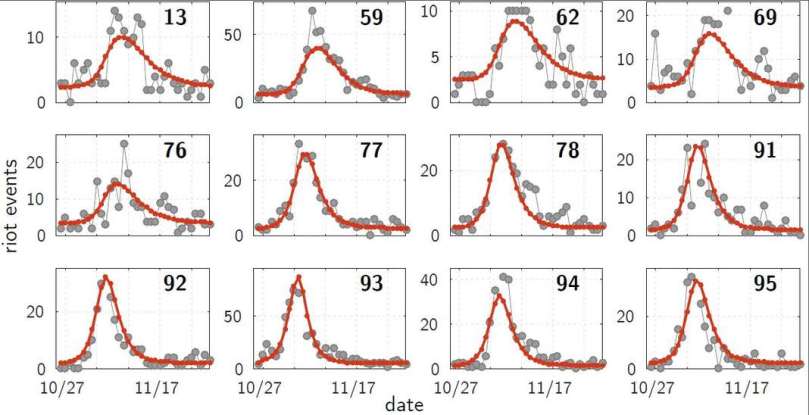Spécialiste de la délinquance et de l’insécurité, Sebastian Roché explique qu’«il y a une baisse constante et régulière du nombre d’homicides sur le très long terme».
Propos recueillis par Nelly Terrier. Le Parisien.
26 septembre 2018, 21h32
Sebastian Roché est directeur de recherches au CNRS et professeur à Sciences-po Grenoble. Ses travaux portent sur la délinquance, l’insécurité, et sur les politiques menées en matière judiciaire et policière*. Il explique ce que « les violences gratuites », dont de nombreux actes ont ému l’opinion ces derniers mois, peuvent signifier.
On a l’impression qu’il y a une augmentation de la violence gratuite, les chiffres le confirment-ils ?
SEBASTIAN ROCHÉ. Pour aborder le thème de la violence qui augmente ou non, il n’existe qu’un critère sûr en criminologie, c’est celui des homicides, car ce sont les seuls chiffres fiables, le roc sur lequel on peut s’appuyer. Que disent-ils ? Qu’il y a une baisse constante et régulière sur le très long terme. En clair, depuis le XIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui, ces chiffres fléchissent constamment. Précisément, en 800 ans en Europe (hors périodes de guerre), on est passé de 50 tués par an pour 100 000 personnes, à 1 pour 100 000 aujourd’hui. Aujourd’hui, l’Europe est la zone la plus pacifique du monde.
Comment aborder alors cette impression d’augmentation de la violence gratuite ?
Ce qui se passe, c’est que ce type d’actes – un homme tué pour une place de parking, une cigarette refusée ou une altercation banale – crée à juste titre une très forte émotion. Mourir pour si peu est intolérable. Émotion d’autant plus forte lorsque la « loi des séries » en accumule plusieurs sur un temps court. Cette réaction d’affect et de colère est absolument légitime et nécessaire. C’est une manière collective de dire : nous ne voulons pas cela, nous n’acceptons pas cela.
Et cela engendre une mobilisation, un besoin de discussion, ce sont des moments, comme les qualifiait le sociologue Émile Durckheim de « renforcement des états forts de la conscience collective ». Ces périodes ont permis au fil du temps d’augmenter le seuil d’intolérance à la violence et d’entrer dans la « civilisation des mœurs ». Un des meilleurs exemples historiques est le moment où il a été décidé que les duels étaient interdits et devenaient hors-la-loi.
Comment réagir aujourd’hui ?
Face aux phénomènes de masse, comme la violence routière ou les violences faites aux femmes, des politiques volontaristes de lutte peuvent être engagées. Pour des faits dramatiques, comme ceux de Grenoble (NDLR : la mort d’Adrien Perez, poignardé à mort) ou de Saint-Pierre-des-Corps (NDLR : Ali Unlu, 43 ans, meurt après avoir été frappé pour une place parking) récemment, mais qui restent peu nombreux, la police et la justice, au-delà de la condamnation à une peine de prison, ont aussi pour fonction de redire l’interdit moral. Les familles sont en droit d’attendre aussi des gestes symboliques des acteurs de l’État qui doivent aussi affirmer cet interdit.
Ces actes violents ont pour point commun d’avoir pour auteurs exclusivement des hommes, peut-on en dire quelque chose ?
Oui, ce sont souvent des altercations au motif futile et, au départ, personne n’a l’intention de tuer. Mais à un moment l’un des acteurs se sent atteint dans son honneur et décide d’infliger un dommage physique pour réparer cet affront. Ce sont des manifestations d’une logique d’honneur en recul.
* Sebastian Roché est l’auteur de «De la police en démocratie», (éditions Grasset).